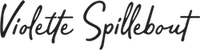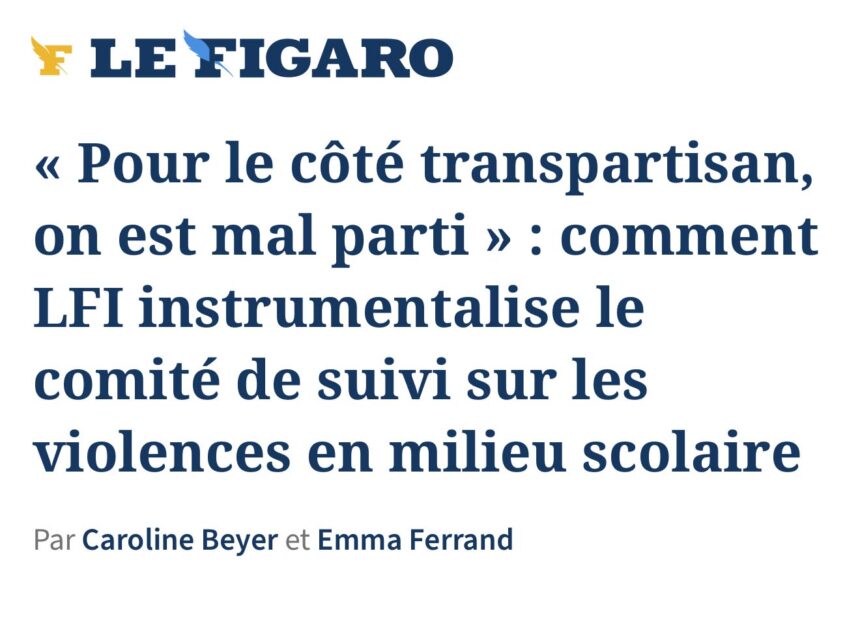Il y a parfois, dans un même article, deux récits qui s’opposent. Celui du Figaro en est un exemple frappant : un titre accusant LFI « d’instrumentaliser » le comité de suivi des violences en milieu scolaire, et un article qui, lui, décrit un travail transpartisan, rigoureux, et assumé. Le titre ne reflète pas l’enquête : il la contredit. Il ne sert pas à informer, mais à rassurer un milieu inquiet de perdre le contrôle du récit et, peut-être, du contrôle sur ses propres pratiques.
Pour soutenir cette fiction d’une instrumentalisation, encore fallait-il me décrire comme une femme influençable, entraînée par un collègue présenté comme le stratège du duo. Cette idée – que je serais sous la coupe de Paul Vannier – est non seulement fausse, mais profondément sexiste. On n’imagine jamais l’inverse : que lui serait instrumentalisé par la majorité ou par le Gouvernement. On n’imagine jamais qu’un homme puisse être « influencé ». Mais une femme, si. Cette asymétrie est révélatrice. Elle dit combien, dans certains récits médiatiques, l’autonomie des femmes politiques reste suspecte, fragile, réductible.
Le Figaro ne dit pas ce qui dérange vraiment : si j’étais la marionnette qu’il suggère, comment aurais-je convaincu mon collègue LFI de venir avec moi rencontrer deux ministres du Gouvernement actuel – Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, et Édouard Geffray, ministre de l’Éducation ? Comment aurions-nous obtenu leur soutien explicite pour consolider nos travaux et conforter la proposition de loi ? Comment ces ministres auraient-ils légitimé, salué et encouragé un texte que nous avons co-construit, si ce travail n’avait pas été sérieux, équilibré et transpartisan ?
Ce qui perturbe véritablement certains milieux conservateurs, ce n’est pas mon collègue LFI. Ce n’est pas moi. C’est que notre travail avance. Qu’il produit des effets. Qu’il ouvre des portes. Qu’il mobilise l’État. Qu’il déclenche des décisions. Qu’il agit, concrètement, pour mieux protéger les enfants. Et cela rend caducs tous les récits commodes qui cherchent à réduire cette démarche à une manœuvre idéologique.
La rhétorique de l’instrumentalisation ne résiste pas aux faits. Elle ne sert qu’à occulter l’essentiel : les violences subies par les enfants, la nécessité de renforcer les contrôles, et l’urgence de mettre fin à un système d’autoprotection institutionnelle qui a trop longtemps prévalu. Face à cela, le titre du Figaro apparaît pour ce qu’il est : un écran de fumée, doublé d’un réflexe misogyne. Une façon ancienne de disqualifier un travail politique, faute de pouvoir en contester le contenu.
On doit enfin rappeler une réalité très méconnue : dans la plupart des rédactions, les journalistes ne sont pas les auteurs du titre final. Le retitrage est une pratique quotidienne, presque industrielle, confiée aux secrétaires de rédaction ou aux éditeurs, qui adaptent — parfois, hélas, qui tordent — le sens d’un article pour répondre à une ligne éditoriale, à un public ou à une stratégie d’audience. C’est sans doute ce qui explique ici l’écart flagrant entre l’article, sérieux et documenté, et le titre choisi, qui en oriente la lecture avant même qu’elle ne commence.
Protéger les enfants mérite mieux que des caricatures. Et la presse mérite mieux que cela aussi.